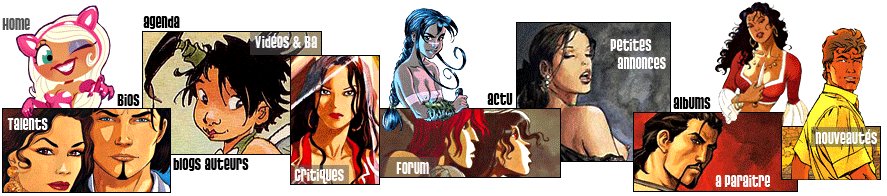
![]()
L'exposition "Muñoz - Breccia (suite) Leur principale création, qui remonte à 1975, est un policier new-yorkais du nom d'Alack Sinner. Si Muñoz et Sampayo épousent les conventions du polar, c'est pour mieux les pervertir. Sinner est un antihéros qui promène sa lourde carcasse meurtrie dans les rues de la métropole américaine, révélant ses désarrois et ses angoisses. La réussite de l'œuvre tient, pour une bonne part, dans sa capacité à donner vie à des personnages d'une épaisseur humaine sans équivalent dans le 9e Art. On leur doit également une émouvante biographie de la chanteuse Billy Holliday, ainsi qu'une série des plus originales dont le "personnage" principal est un café, Le Bar à Joe. Cet établissement est une véritable Babel fréquentée par des individus d'origines les plus diverses, chacun amenant sa propre histoire. La biographie des auteurs explique en grande partie l'omniprésence du thème de l'exil. Plus récemment, Muñoz a réalisé plusieurs bandes dessinées scénarisées par l'écrivain américain Jerome Charyn avant de collaborer avec Daniel Picouly pour un album à paraître en janvier 2003. L'influence de José Muñoz est considérable ; on ne compte plus les dessinateurs sur lesquels il a exercé une influence profonde. Parmi ceux-ci, on relève les noms d'Edmond Baudoin, Frédéric Bézian, Lorenzo Mattotti ou Dave McKean. José Muñoz : Oui, à Buenos Aires. C'était déjà une ville très grande,
avec le mélange de natifs avec tous les immigrants européens. A l'époque,
l'Argentine était plus riche, plus solide que maintenant. Loin des conflits
mondiaux, le pays avait plus d'espérance. Mon père avait entamé des
études d'ingénierie aéronautique, mais il les abandonna pour s'occuper
d'un commerce de chaussures avec sa famille. Ils sont arrivés à posséder
trois boutiques, deux à Buenos Aires et une autre en province. On peut dire cela. Nous habitions La Paternal, un quartier central de la ville, fait de maisons longues et étroites aux patios arborés baignés de lumière où poussaient des figuiers et des vignes. Un endroit magique! Mon père jouait dans le club de foot amateur du quartier. J'ai deux sœurs, je suis au milieu. La grande sœur a quatre ans de plus que moi et ma jeune sœur un an de moins. A ce moment, cela a donné naissance, pour les travailleurs, à une grande espérance dans la construction d'un pays plus digne. L'Argentine était alors très riche. Le Péronisme paraissait une bonne chose pour les travailleurs. C'étaient des dictatures de politiciens roués, amoraux, des groupes de militaires, des hommes avec un gros complexe de virilité, agressifs… Cela vient de la structure de la propriété dans notre pays. L'Argentine est un pays composé de gros propriétaires de latifundias, dont la mentalité démocratique n'était pas très développée. Il y a des quotas pour les émigrants, qui sont vus comme des envahisseurs, des gens dangereux, inutiles. Pas dans le sens qu'ils n'avaient pas de bras pour travailler. Plutôt dans le sens des idées qu'ils importaient avec eux. Les propriétaires du pays étaient très préoccupés de contrôler la pensée et le développement des gens. Leur souhait était que l'Argentine soit une grande hacienda avec des vaches. Car les vaches sont plus contrôlables que les hommes… Pour ces propriétaires, c'étaient les plus dangereux. Leur liberté de propos était très mal perçue par la classe dirigeante argentine. Les idées venues de l'étranger étaient un danger pour ces gens rétifs au progrès social. Le premier Péronisme promouvait cet idéal socialiste, on doit le dire, d'une façon perverse, mais avec un discours progressiste. A ce moment-là, celui des années quarante, avec la splendeur du tango, l'idée péroniste d'offrir aux travailleurs un accès à la dignité était très émouvante. Totalement. Il se méfiait de la politique. Il pensait parfois que l'affiliation politique était un outil nécessaire quelquefois, mais il est resté en marge. Le péronisme arrive au pouvoir en 1946, avec une majorité absolue pour Perón lors des élections libres, de même que dans l'élection suivante. Mais après, l'allégresse retombe, car le pays tombe dans les difficultés tandis que les voleurs continuent de se servir largement. L'Argentine a commencé à chuter. Devant les excès antidémocratiques de certaines factions du péronisme, un mélange d'exhibitionnisme viril et de rage de la confrontation primaire, en même temps qu'une influence croissante des Etats-Unis, la classe moyenne a commencé à douter. Le régime péroniste devenait aussi de plus en plus paranoïaque. Le caractère original du mouvement social incarné par le péronisme a fini par être rejeté par les « forces vives de la nation ». Celles-ci ont avec la Revolución Libertadora . C'en était fini de la dignité du travailleur argentin.
Mon premier souvenir de lecture, c'était Bucky Bug des studios Disney . J'avais 5 ans et je ne savais pas encore lire. C'était un couple d'insectes vivant dans un dépôt d'ordures, et notamment dans une chaussure transformée en maison bourgeoise. C'était une BD écologique avant la lettre, parce que tous les objets jetés étaient recyclés. Les boites à sardines, affublées d'un mât, devenaient des voitures automobiles, des bateaux. C'était une BD que j'aimais beaucoup, sans rien y comprendre. Plus tard, je fus touché par l'école argentine moderne qui tourne autour de l'écrivain Hector Œsterheld et le magazine Misterix, et des dessinateurs comme Hugo Pratt , Alberto Breccia, Solano López … que je lisais quand j'avais dix ans. Polisseur de métaux. J'étais l'aide d'un ouvrier plus âgé. Plus tard, j'ai lustré des meubles pour un ébéniste. A douze ans, je commence les cours dans La Escuela Panamaricana de Arte où enseignait Alberto Breccia. Oui. J'avais renoncé à mes études secondaires parce que je voulais dessiner. Dans la classe, j'étais un des plus jeunes, mais on trouvait aussi des personnes de trente ans. Breccia était doué pour gérer ces différences. Je connaissais son dessin pour avoir lu sa bande dessinée Vito Nervio dans El Patoruzito. C'était une BD noire écrite par Wadel.. Il ne travaillait pas encore avec Œsterheld. Alberto Breccia avait environ trente ans, une grande prestance ; il avait un corps de danseur de tango, les cheveux gominés, la fine moustache bordant les lèvres… Pour les amateurs de bandes dessinées, c'était une star. Il m'apparaissait alors comme un professeur sévère qui ne laissait pas transparaître son allégresse. Il était toujours sérieux quand il travaillait. Il était très exigeant, mais j'aimais cela. Je suivais ses cours de façon clandestine, parce que, par ailleurs, je prenais des cours de peinture et de sculpture avec un sculpteur argentin d'origine italienne du nom d'Umberto Cerantonio, qui voyait d'un mauvais œil que je fasse des bandes dessinées. Pendant ce temps-là, je travaillais toujours pour gagner ma vie. J'allais au cours de Breccia à la Escuela Panamericana, de 17h30 jusqu'à 20h30, deux fois par semaine. Avec Cerantonio, je travaillais aux mêmes heures les autres jours. C'était fatigant, mais très intéressant. J'ai fait cela jusqu'à l'âge de quatorze ans.
J'étais allé voir Breccia pour lui demander s'il pouvait me trouver du travail. Il a contacté un autre professeur de la Escuela Panamericana qui s'appelle Peireyra et, tous les deux, ils m'ont trouvé une place d'assistant auprès de Solano López, le dessinateur de L'Eternauta, à mon sens, l'une des meilleures BD mondiales. Les dernières 50 planches de la première série de l'Eternauta sont pleines de mes coups de pinceaux, de mes erreurs. Solano reprenait mes dessins à la gouache. Mon arrivée au studio de Solano López est assez extraordinaire. C'était un après-midi de janvier, très chaud en Argentine. Il habitait au quatrième étage. Arrivé là-haut, je trouve deux types dont l'un était très bien mis, habillé d'une chemise élégante et propre, coiffé de brillantine. Il était assis face à une petite table de dessin sur laquelle il y avait des planches. L'autre type dans la pièce, assis face à une grande table à dessin, était habillé de façon plus débraillée, pas très élégante, du genre prêt à partir jouer au foot à 5 heures. Je me suis dirigé vers celui qui me semblait être le patron, qui avait une présence plus nette, en lui disant : « Bonjour Monsieur Solano López, je suis José Muñoz. Breccia m'a dit que… ». Je m'adressais bien entendu à son assistant. Elle est problématique à cause de la lutte entre les généraux de la droite extrême et ceux de la droite démocratique, parce que l'on voulait punir le peuple argentin pour les vertus péronistes. D'un côté, les grands propriétaires vivaient dans la peur d'une insurrection de type communiste. De l'autre, les travailleurs vivaient dans la peur de la répression de la part des militaires. Bien entendu, le péronisme égocentrique et surtout l'entourage de Perón ont permis des dérives qui ont fait le lit des régimes autoritaires qui lui ont succédé.
Non. Je lisais les journaux. J'écoutais les adultes. J'écoutais Solano López… Mais j'étais surtout investi dans mon plaisir de dessiner pendant ces années fatales où s'installe la tragédie. Ce n'est que plus tard que je comprendrai la portée de mes conversations avec Solano sur le drame du Paraguay comme une illustration de la future situation du continent, et aussi les expériences que j'avais acquises dans la fréquentation des cercles collectifs de Buenos Aires : les étudiants, les universitaires, les écrivains, les journalistes, les artistes… Cela a été mon passage vers la prise de conscience. Une première époque va de mes quinze ans jusqu'à mes 17-18 ans. Plus tard, je réussis à illustrer directement des histoires pour Œsterheld. J'avais fini par me faire connaître de la maison d'édition en allant porter les planches de Solano et ils m'ont donné un travail personnel à côté de celui que je faisais pour lui. Notre production était d'environ 25 dessins par jour. Au début, nous étions deux assistants. Celui que j'avais rencontré, Julio Schaffino, est resté environ six mois, le temps de me former. Puis, je suis resté seul pendant un an et demi. Quelques mois avant mon départ, un nouvel assistant est arrivé pour que je puisse le former. C'était le jeune frère de l'assistant qui m'avait précédé !
Non, car à un certain moment, c'est la chute de la maison d'édition Frontera des frères Œsterheld. Ils sont entrés dans des discussions avec la vieille garde des dessinateurs qui étaient à l'origine de la maison d'édition. Ils la considéraient comme une coopérative. Ce qui n'était pas l'avis des Œsterheld qui jugeaient en être les propriétaires. Par ailleurs, avec la dépréciation du peso argentin à la suite de la chute de Perón, tous ces auteurs passèrent chez un éditeur anglais, Amalgamated Press. Ils illustraient des textes qui n'avaient pas la qualité de celles d'Œsterheld, mais ce renoncement artistique était compensé par un avantage économique.
Il y avait deux clans. Celui d'Œsterheld qui était une bande dessinée très développée. L'autre clan était constitué autour de Dante Quinterno, l'auteur de Patoruzù, la pierre angulaire de la BD humoristique argentine pour enfants. J'adorais cette BD, mais je la voyais comme une autre planète. L'un des meilleurs dessinateurs de ce groupe était Battaglia , un scénariste et un dessinateur d'une grande inventivité. Breccia aussi faisait partie de la planète « quinternienne », avant de passer sur l'astre «œsterheldien ». Entre Pratt et Breccia, il y avait comme le clair et l'obscur. Pratt, c'était le vent dans les feuilles, la douceur et la vigueur du pinceau. Quand il faisait des éclairages dans le ciel, comme dans Ticonderoga, avec des effets de lavis… Chez Breccia, c'était plutôt un orage créatif, on pourrait dire : plus « expressionniste allemand ». Si tu te mets devant ses planches et que tu fais abstraction de l'histoire, tu ne vois plus que la distribution des taches, avec cette noirceur entre les différents types de gris qui dégagent une émotion intense. Breccia permet de tenter d'émettre l'hypothèse d'une « peinture dessinée ».
Je crois que, comme il y a une ligne claire dans le dessin et une ligne obscure, il existe un romantisme clair et un romantisme obscur. Comme le jour et la nuit, ils se complètent un peu.
La chute de Frontera pousse Solano à faire carrière en Europe où il travaille pour les Anglais. Il ne reviendra qu'en 1964. Je me retrouve donc sans boulot. J'avais illustré quelques textes pour des éditeurs d'Amérique centrale. On m'a même demandé à un moment de dessiner des BD anti-castristes. J'ai fini par ne pas les faire. Pour ajouter à cette situation, j'étais un militant assez actif auprès du syndicat de la presse où je représentais les dessinateurs. Comme j'étais un des instigateurs d'un front uni de dessinateurs contre les excès des éditeurs, je figurais sur une liste noire. Il était interdit de me faire travailler.
Oui. Il revient avec beaucoup de travail. J'ai alors repris le poste d'assistant que j'avais quitté dix ans auparavant. La plupart des récits anglais qu'il ramène sont de sombres conneries, à l'exception de celles écrites par l'écrivain Tom Tully. Pendant ces cinq nouvelles années que je vais passer aux côtés de Solano, aidé par une psychanalyse, j'ai fait un travail de réflexion. J'abandonnai peu à peu mes activités syndicales pour me consacrer à mon plaisir premier : le dessin. Oui. Comme je ne trouvais pas assez d'espace pour moi à Buenos Aires, je partis pour Londres rejoindre un grand ami, le dessinateur Oscar Zarate. Je cherchai du travail à Milan, sans succès. Je me rendis ensuite en Espagne. Dans l'Espagne franquiste, la Guardia Civil était partout. Une atmosphère oppressante. Le régime de Franco était une dictature qui avait réussi à s'insinuer dans les esprits, après 40 ans de répression, de délire catholique teinté d'un extravagant désir de conquête, où la fierté espagnole se donnait une « mission évangélique ». C'était l'alliance de la croix et de l'épée. Ce type de délire était le même que celui que j'entendais chez les généraux argentins. Je suis donc revenu à Londres où j'ai trouvé du travail. C'était le même type de boulot que celui que je faisais pour Solano López, sauf que là, je travaillais directement pour les éditeurs anglais, dans des magazines pour adolescents. Je trouvais les histoires idiotes, mais après les textes d'Œsterheld, comment aurais-je pu avoir une autre opinion ?
Avec mon épouse, nous avons eu une fille et je me suis stabilisé. La vie de Londres, à cette époque, était assez douce. C'était la fin de la période hippie à laquelle j'avais timidement goûté à Buenos Aires. Mais après cette douceur, est venue la catastrophe. Je me suis séparé de ma femme qui est allée revivre en Argentine avec ma fille. J'ai interrompu le travail avec mes éditeurs anglais. Je suis resté en Angleterre jusqu'à l'expiration de mon visa, vivant dans une communauté, gagnant ma vie en faisant la plonge pour une cantine scolaire. Nous étions trois à faire ce travail, chacun travaillant seulement un jour et demi par semaine. C'était cool. Je me suis reposé ainsi pendant huit mois, et puis, je suis parti à Barcelone durant l'été de 1974. Quand j'arrivai sur la côte, Sampayo, qui m'avait été présenté par Oscar Zarate, venait de se séparer de sa femme, lui aussi. Je le retrouvai dans son petit village, et nous nous jetâmes l'un et l'autre dans le travail devenu une thérapie plus que jamais. C'est là que nous créons Alack Sinner. Oui, plus tard, et sans enthousiasme. Il y était resté pendant toutes ces années de la dictature. Il avait deux filles et un fils. A la fin des années '80 et au début des années '90, il est venu ici. Mais pas pour y construire sa vie. Il a été très touché par le respect que les Européens portaient pour son travail. Quand je suis parti, j'avais 29 ans. Je n'ai pu y revenir qu'à l'âge de 42 ans, à cause de la dictature, de cette tuerie généralisée, de la peur. Aujourd'hui, par un effet de nostalgie lié aux souvenirs de mon enfance, il y a, sur son évocation, une lumière dorée qui contraste avec le souvenir de cette terreur.. Mon enfance devient comme un pays doublement exotique, par son décalage avec la réalité, par son irréalité même. Les dessins que j'invente font surgir des moments de l'enfance. Ce n'est pas une nostalgie « victimiste », étrangement ; elle intervient plutôt comme une stimulation, un refuge de l'esprit. C'est un pays qui est en train de « se faire disparaître ». J'y suis retourné, bien sûr, dès que j'ai pu le faire. Mon père est mort lorsque j'étais en Europe, en 1975. Mais ma mère et mes deux sœurs y sont restées. De même que ma fille. Je regarde cet écroulement bancaire ambigu, lourd de conséquences, ce pays qui chute face à une expérimentation économique extrême. Il y a eu ces dernières trente années, en Argentine, une sorte de dictature économique libérale qui aboutit à cette dépression qui s'accompagne d'une dépréciation de l'individu, et qui se traduit par une absence de respect de l'autre, comme si le monde était une entreprise sauvage où le but de chacun est de voler son voisin. Ce « paradis libéral » est arrivé à un point d'écroulement, un tel état de défragmentation, que je me sens comme dépossédé de mon souvenir et la situation actuelle est aussi angoissante qu'une histoire d'Œsterheld dessinée par Breccia, à la sauce Borges : on en arrive à l'idée confuse que tout ce qui est de l'ordre du souvenir est une invention de son imagination.
Il y a, dans ce roman de Philip K. Dick, dont on a tiré le film Blade Runner, l'idée que les Réplicants ont, dans la mémoire, une zone affective factice. Je me rends compte de ce que l'Argentine s'efface de ma mémoire et disparaît, car elle refoule la réalité horrible dont le résultat est ce qui se passe aujourd'hui : un pays qui, après avoir été privatisé à vil prix pendant trente ans, a vécu une expérimentation capitaliste extrémiste qui apparaît comme le symbole de ce qu'il adviendra de l'humanité dans le futur. C'est la menace que représente un système marchand où les intérêts commerciaux, livrés à eux-mêmes sont incapables de proposer autre chose qu'une « digestion » et une évacuation de l'autre, de la planète, voire de l'univers entier. Le manque de contrôle de l'économie de la part de ces « délégations tribales » qui administrent nos états est directement responsable de cette situation où la société perd toute dimension civilisée, humaine et digne. Dernièrement, le Fonds Monétaire International et tous les autres clubs de banquiers supranationaux, si plaisants et si ingénieux, se sont mis à penser que, peut-être, ils se sont trompés. La traduction affective que cela m'évoque, c'est que Pratt, Breccia, Solano López, la jeunesse, le soleil, ne seraient plus que le fruit de mon imagination… C'est terrible ! C'est aussi pour cela que je dessine, pour toucher concrètement du doigt la vie, ma vie. Propos recueillis par Didier Pasamonik, le 7 octobre 2002.
(10) Devenu président de l'Argentine trois ans après
un coup d'état qui lui permit d'accéder à la popularité auprès des masses
ouvrières, Perón créa un régime autoritaire basé sur l'armée, la police
et les syndicats. Il nationalisa les chemins de fer et la banque centrale,
remboursa la dette étrangère, et mena une politique économique et sociale
fondée sur le justicialisme, une doctrine inspirée par le corporatisme
mussolinien. Profitant des réserves accumulées pendant le seconde guerre
mondiale, le pays vécut une décennie de prospérité pendant laquelle
Perón fut réélu en 1951. Mais la situation politique et économique se
dégrada et il fut renversé par les militaires en 1955. Exilé en Espagne,
il revint au pouvoir en 1973. A son décès en juillet 1974, sa troisième
femme accéda à la présidence et fut renversée en 1976 par la junte dirigée
par le général Videla.
Images Copyrights © Breccia & Munoz 2002 |
|||
© BD Paradisio 2002 - http://www.bdparadisio.com