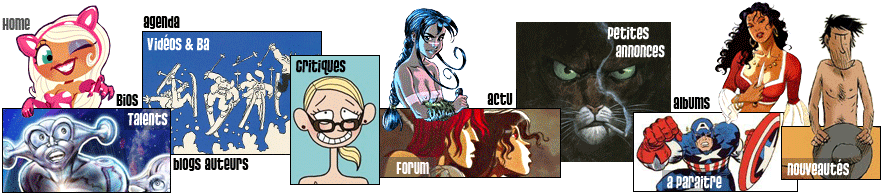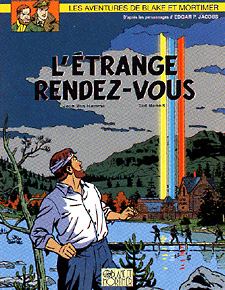
Pour commencer, car je me fiche comme d’une guigne de ce débat, je ne suis ni “Van Hammophile”, ni “Van Hammophobe”. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas qui dessine ou fait le scénario, mais le résultat à l’arrivée. Alors voilà pour le résultat à l’arrivée : - En ce qui concerne les dessins, je n’ai aucune raison de trouver que Ted Benoît dessine plus mal que dans “L’affaire Francis Blake” , ou que Jacobs lui même (en clair, il dessine bien, me semble t’il). J’avoue que la prédominance de la couleur orange dans la coloration ne m’avait pas frappé. Moi, je trouve la coloration bonne. En revanche, la couverture m’a choqué : d’abord les couleurs criardes du triple rayon (on croirait un élève de maternelle qui a sorti ses pinceaux), et puis le fait que deux scènes temporelles distinctes s’y superposent : Mortimer poursuivi par les “Jaunes” ne voit pas en même temps les fameux rayons. “Simple détail”, me dira t’on, et c’est sans doute vrai. - En ce qui concerne le scénario, je suis plus mitigé : l’histoire (et particulièrement l’épisode de la Guerre d’Indépendance américaine) me semble excellente... jusqu’à la page 32, tout du moins. C’est à dire que le récit est passionnant tant que le mystère n’est pas élucidé... mais ensuite, quelle déception ! D’accord à la rigueur pour les futuristes venus se venger de nos inventions nucléaires, quoique je pense que l’on pouvait trouver mieux. Ensuite, le “come-back” de l’incontournable - et increvable - Olrik qui, à mon sens, est devenu un “méchant” superficiel et sans envergure, contrairement à certains récits de la période “Jacobs”. Et voilà en prime Basam Damdu et ses vilains “Jaunes” ! Et là, je dis : “les clins d’oeil et les courbettes en hommage au grand maître, ça va un instant, mais il y a un jour aussi où il faut que ça s’arrête !” Tant qu’à faire, on aurait aussi bien pu inviter Sharkey, Nasîr et le sheikh Abdel Razek, on aurait pu mettre la nappe sur la table pour le“goûter annuel des anciens combattants” ! Enfin, la bataille finale entre les “Jaunes” et le FBI est mortelle, mais pas seulement pour les acteurs en question, mais d’ennui pour le lecteur. Alors maintenant, les bons points : l’histoire est dense et passionnante dans sa première partie. Je le répète : les dessins sont bons. Enfin, depuis “L’affaire Francis Blake” et “La machination Voronov”, cela faisait deux albums de suite où la science-fiction était absente, et même si je respecte les opinions des amateurs d’histoires d’espionnage, je me dis que deux de suite, cela en fait un de trop pour une série comme “Blake et Mortimer”. Alors merci aux auteurs pour avoir réintroduit le genre S-F qui était tout de même la marque principale de la période “jacobsienne” ! Un ultime commentaire sur les “Jaunes” (j’ai cru comprendre qu’ici ou là, chez certains lecteurs, l’expression avait très mal passé). Le problème, c’est que “Le secret de l’Espadon” (auquel fait référence l’album sur ce point) a été élaboré dans l’immédiate après-guerre, à l’époque où le souvenir de l’impérialisme nippon était encore frais dans les mémoires, et que le mythe du “Péril Jaune” était encore à la mode. De ce point de vue, la transposition au début du 3° millénaire est malheureuse, d’autant plus que si Van Hamme les appelle “les Jaunes”, c’est probablement parce qu’il ne peut pas les appeler “les Tibétains”, qui, loin d’être impérialistes, sont devenus le peuple martyr que l’on sait de la main de la Chine communiste de Mao. Comme quoi, Jacobs ne n’y entendait pas beaucoup en matière de géopolitique (en revanche, il serait inique de l’accuser d’avoir été raciste). Comme quoi aussi, le désir constant de rendre des hommages posthumes au “Maître” pour satisfaire les goûts conservateurs d’un public qui tourne de l’oeil dès que sa série favorite se trouve un tant soit peu modifiée, trouve ici, plus que jamais, ses limites.