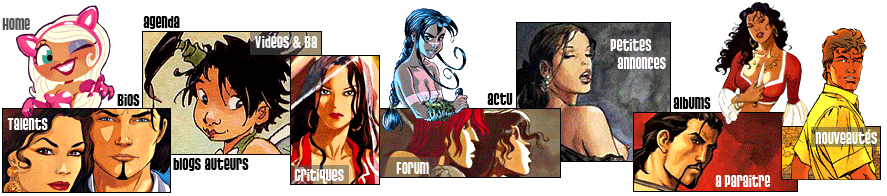Igor, mon frère (Vlad) par Thierry Bellefroid 

« Vlad », Tome 1 : par Griffo et Swolfs dans la collection Troisième Vague du Lombard.
La cohérence de la collection Troisième Vague s'affirme avec de plus en plus de clarté. Ce qui paraissait encore très confus lors de la première livraison (composée, pour rappel, de deux séries pré-existantes : Alpha et Capricorne) a depuis trouvé une véritable justification... ne fût-ce que commerciale. Au Lombard, on se félicite en tout cas des chiffres réalisés depuis la création de cette collection. C'est vrai qu'Yves Sente a réussi à sortir la BD-Lombard de placards qui sentaient dangereusement la naphtaline. Mais qu'on ne s'y trompe pas, si Troisième Vague regroupe des récits aux héros et au contexte modernes, il ne s'agit nullement d'un vivier de jeunes auteurs. Jugez sur pièces. D'abord, il y a eu les deux séries citées plus haut, déjà bien installées dans le paysage, et dont les auteurs n'étaient plus des inconnus (sauf peut-être Jigounov). Puis il y a eu IRS, Niklos Koda et Alvin Norge, des séries scénarisées ou dessinées par des auteurs présents dans le circuit depuis bien longtemps. Voilà que les rejoignent Griffo et Swolfs. On ne peut pas vraiment parler de « petits nouveaux » ici non plus. En clair, les auteurs Troisième Vague ont plutôt tendance à avoir vingt ans de métier ! Pourtant, fidèles à ce qu'ils ont ressenti comme un esprit d'écurie, les voilà qui « font » du Troisième Vague comme d'autres « feraient » du Vécu. Ca donne Vlad, un album que je considère comme l'un des plus réussis de la collection, même s'il véhicule pas mal de poncifs.
Vlad. Swolfs n'a pas dû se creuser beaucoup pour trouver le nom de son héros. Prenez un nom de ville russe et enlevez-lui la moitié. Vous obtiendrez un prénom de héros de BD tout à fait acceptable. A quand les aventures de « Nov », le héros qui rappellera « Novgorov », la ville où le KGB avait installé sa célèbre école ? Vlad, donc, est un ancien héros de l'armée... russe. Aïe. On sent qu'Alpha n'est pas loin. Quand une série marche, il y a toujours du monde qui se bouscule dans son orbite ! Va-t-on assister à une « alphaïsation » de Troisième Vague ? Le risque est là. Mais la lecture de cet album vous rassurera. Vlad est plus qu'un alibi pour promouvoir le succès de la collection. Contrairement à un certain Larry B Max (IRS) auquel je n'arrive pas à croire, ce Vlad semble crédible. Premier bon point : Swolfs a créé un personnage qui, pour outrancier qu'il soit, peut exister. Second bon point, un scénario solide, même s'il n'est pas d'une originalité renversante. Le coup du frère jumeau qui cache une sorte de négatif du héros, l'industrie du cinéma en 3-D complètement aux mains de la mafia russe, l'organisation internationale aux pouvoirs illimités, tout ça fonctionne plutôt bien. Pour le reste, c'est davantage l'action qui est le fil conducteur et l'assurance contre l'ennui du lecteur. Quant à Griffo, il semble moins à l'aise dans la Russie futuriste que dans la Venise de Giacomo C. Les couleurs sont moins soignées (même si l'on sent qu'il y a ici une volonté de ne pas céder à l'esthétisme) et les décors en général sont moins réussis que dans d'autres travaux récents (comme La pension du Dr Eon) Mais son Vlad est animé du même souci de crédibilité et il ne s'en sort pas trop mal. Reste la talon d'Achille de l'ensemble. Tout cela est très attendu et conventionnel. A tel point qu'on a presque froid dans le dos quand Yves Swolfs déclare dans le dossier de l'album que ce qu'il aime de plus en plus dans ses histoires, c'est de « travailler » la psychologie de ses héros. Où est la psychologie de Vlad ? Où est cette fêlure que son auteur se vante d'avoir voulu restituer ? Il n'y a aucune honte à faire de la série B honnête. Mais dans ce cas, il faut assumer. La lecture de Vlad est plutôt agréable. Elle repose sur un certain nombre de recettes que Swolfs a appris à gérer « en routier de la BD » et que Griffo restitue avec le même professionnalisme. N'empêche. On attendra la suite pour voir s'il y a lieu de parler de « psychologie de personnages ».