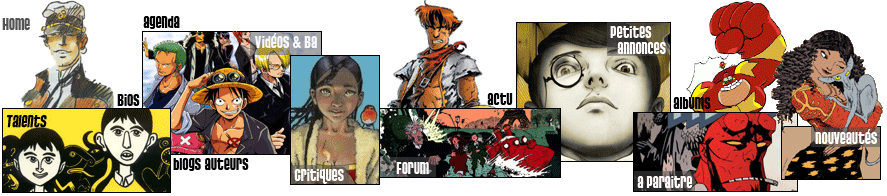La Terre sans mal par Thierry Bellefroid 

« La terre sans mal » de Anne Sibran et Emmanuel Lepage, dans la collection Aire Libre de Dupuis.
Décidément, Aire Libre nous gâte. Si les choix éditoriaux de Dupuis me laissent généralement assez froids, ceux du directeur de cette collection de prestige, en revanche, se singularisent par une qualité constante et un souci permanent de séduire un lectorat adulte avec des histoires accomplies.
Si vous avez vu le film de John Boorman, « La forêt d'Emeraude », vous ne pourrez vous empêcher d'y penser en lisant « La terre sans mal ». Pourtant, il y a autant de ressemblances que de différences entre ces deux histoires et ces deux démarches. Dans « La forêt d'Emeraude », un enfant blanc élevé par les Indiens d'Amazonie va découvrir sa différence, retrouver son père et mesurer le danger que font peser les Blancs sur la forêt. Dans « La terre sans mal », une ethnologue choisit d'épouser la longue errance indienne, d'abord pour des raisons scientifiques puis pour des raisons de coeur. Pas de grand barrage, de route transamazonienne, de menace blanche. Nous sommes à l'aube de la deuxième guerre mondiale, les Blancs s'aventurent à peine au coeur de la grande forêt. Eliane Goldschmidt est ethnologue. Elle arrive en observateur. Elle étudie la langue des Indiens Guarani. Et découvre un événement qui ne s'est plus produit depuis des décennies : la venue du Karaï, un chaman qui va emmener les Mbyas dans une marche harassante, pour ne pas dire suicidaire, vers le paradis, cette « Terre sans mal » qui a donné son nom à l'album.
Anne Sibran nous raconte un conte ethnologique, une quête spirituelle, l'histoire d'un passage. Elle n'a pas besoin de grossir le trait, de montrer l'homme Blanc détruisant la forêt, menaçant les Indiens. Cette ethnologue de formation préfère se mettre d'emblée du côté des Indiens et les montrer vivre...ou mourir. Et puis il y a le regard d'Eliane, la scientifique qui va dépasser ses limites et ses peurs pour accomplir le destin collectif des Mbyas. Enfin, il y a la forêt. Elle est partout, dense, oppressante. Avec sa lumière indirecte et ses couleurs changeantes.
Assez parlé du scénario. « La terre sans mal » n'est pas seulement une bonne histoire (même si on peut lui reprocher d'être parfois un peu lente). C'est surtout une grande BD. Et pour ça, il fallait un grand dessinateur. C'est Emmanuel Lepage qui a endossé la lourde responsabilité de mettre des images sur les mots de Anne Sibran. Il y est tellement bien parvenu que de nombreux amateurs de BD achèteront cet album après l'avoir feuilleté deux minutes chez leur libraire favori, sans même connaître l'histoire. Lepage s'est surpassé. Son travail plein de sensibilité m'avait beaucoup plu dans la série Névé (sur scénario de Dieter, Intégrale disponible et hautement recommandée chez Glénat !) Ici, pour la première fois en couleurs directes, il donne toute la mesure de son talent. On sent la documentation, bien sûr, mais jamais trop. On sent surtout des lumières, des ambiances et des personnages parfaitement maîtrisés. Lepage a choisi de n'encrer que les avant-plan, le reste est peint sur les crayonnés, ce qui donne lieu à des images superbes, dégradées, où l'aquarelle se délie pleinement. Les Indiens sont stupéfiants de beauté et de force. Et puis, il y a Eliane, cette héroïne magnifique, touchante, belle sans être un « prototype ». On ne referme pas « La terre sans mal » après l'avoir terminé, on le feuillette encore un peu. Pour prolonger le plaisir.