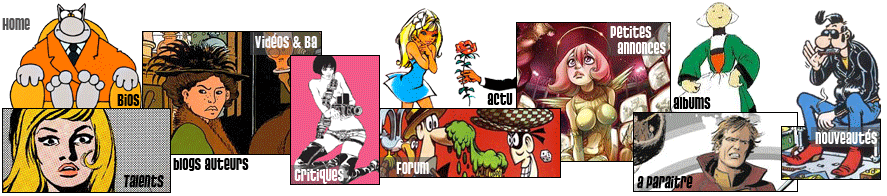Variations sur un même thème ? Depuis le “Journal de mon père” et l’homme qui marche” (je mets volontairement de côté « le chien Blanco »), Tanigushi continue à nous conter des histoires différentes mais qui s’articulent toujours des mêmes thèmes. Le (difficile) passage de l’adolescence de Hiroshi qui est évoqué ici fait indéniablement écho à celle de Yiochi dans « le Journal de mon père ». Comme si des choix de notre enfance, dépendait la pleine réalisation de notre vie d’adulte. Il nous est tous arrivé un jour, le souhait de tout recommencer. Ce fameux « et si j’avais… », en espérant que la vie prendra une autre tournure et correspondra de manière plus satisfaisante à nos attentes. Comme si la pleine réalisation de nos rêves, était la condition majeure pour la réalisation de notre vie : le plein-épanouissement, la pleine réalisation du moi sans laquelle nous nous considérons comme des êtres incomplets. Cette idée de destin et de continuité dans toute chose est très spécifique de la philosophie de vie japonaise. Dans « Le Journal », les blessures liées au départ inexpliqué de la mère et l’éloignement du père faisaient que le héros n’arrivait pas à réaliser sa vie de jeune marié, préférant se réfugier dans son travail. Ici, c’est le départ inexpliqué du père et ses conséquences sur le destin des protagonistes qui est évoqué. Les deux héros sont condamnés à vivre au sein d’une famille monoparentale et sont ainsi obligés de subir les conséquences du choix des autres. Dans le premier cas, c’est en faisant le deuil du père et en pardonnant à sa mère, qu’il se donne une seconde chance. Dans « Quartiers lointains », Hiroshi a l’opportunité miraculeuse de tout recommencer. Il est aussi indéniable que malgré ses maux, l’adolescence reste lié à l’idée de famille telle qu’elle n’existe plus au Japon. Tanigushi nous ramène à cette période de l’après-guerre, dans une structure familiale où trois générations vivaient sous le même toit. Dans les deux histoires, on quitte la métropole et on regagne la province. L’occupation militaire américaine (et accessoirement l’humiliation de la défaite) était indirectement évoquée dans le « Journal », la guerre est aussi évoquée par la disparition de premier époux et la famille recomposée. Tanigushi lève un voile pudique sur un sujet tabou au Japon. Autre détail, les métiers de l’enfance sont liés au petit commerce de province et les métiers d’adulte sont liés au grand capitalisme. Le contraste est d’autant plus frappant qu’il se réfère à une société moderne stressée, individualiste, oublieuse des vraies valeurs, calculatrice : Hiroshi adulte boit et oublie, l’ « homme qui marche » marche et reprend contact avec la nature. Autre contraste, la décision de sa fille d’aménager avec son compagnon (et de quitter le domicile familial), même si la scène est rêvée par un Hiroshi (re)devenu adolescent s’oppose au fatalisme avec lequel la mère de Hiroshi accepte le futur départ du père. Autre temps, autres mœurs ? Cette référence à l’âge d’or, au Japon d’avant est aussi évoquée de manière plus formelle et didactique dans « Au temps de Bochan » qui, à dire vrai, m’a laissé de marbre. Bien plus, son message semble nous dire que la génération de 45-50 ans, a été sacrifiée sur l’autel de la réussite et du grand bond industriel de l’après-guerre (de la même manière l'ère Meiji avait sacrifié le Japon traditionnel). Mais n'est-ce pas cher payé? A bien des égards, l’auteur en fait son œuvre la plus aboutie (mais si ceci ne reste qu’un premier tome).