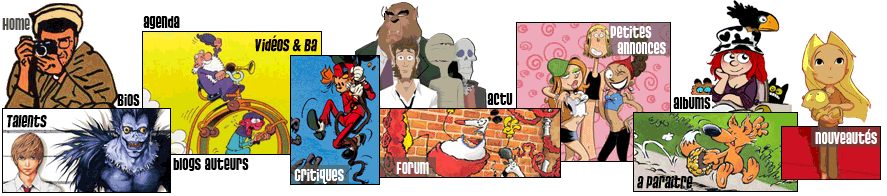
Lewis Trondheim (2)
|
453. philma |
|
Si si il est cité dans un autre poste( j'ai même rippé sur mon clavier). Je précise que j'aime bien JVH comme easy reading de temps en temps.
|
|
452. rough
|
|
(il faut bien, c'est son seul et unique BON film... ! quel gâchis mine de rien...) euh, là pas d'accord du tout, des fois tu dis des betises :D x men 1 et 2 sont une réussite pour moi: je n'ai certe pas la culture comics de mon pote nemo, et suis donc moins tatillon sur l'authenticité sans faille par rapport au comic original, mais, en tant que cinévore ( je n'aurais pas la prétention de me qualifier de cinéphile ( d'ailleurs je crois que le vrai cinéphile c'est extrement rare de nos jours ), et professionnel de l'image/narration, c'est selon mes goûts et mes critères une excellente adaptation personnelle et artistique de ma conception du comic x-men. je ne vois pas en quoi c'est raté pour ma part. ( meme si je prefere le 2 ) J'attend egalement beaucoup de son superman return, qui me semble plus que prometeur au vu de ce somptueux teaser… |
|
451. philma |
|
Oui, je crois qu'il peut y avoir exception pour ceux qui travaillent de façon fusionnelle(Sampayo, Peeters, sans doute Martiny avec petit-Roulet et quelques autres).
Mais cette idée est globalement très intéressante et expliquerait sans doute nombre de ratages d'écrivains reconnus qui "passent" à la bd. |
|
450. labonneblague
|
|
Est-ce que Luc Brunschwig, le meilleur scénariste du moment si j'en crois ce forum, sait dessiner ????
|
|
449. Bert74 |
|
...ah ! Moore dessinait lui aussi à ses débuts (des histoires de chats médiums ou je sais pas trop quoi)...;0)
Mais, d'accord, on peut le classer chez les exclusivement scénaristes ;0) Sinon, je suppose que c'est exprès que Van Hamme soit pas cité dans ta liste... |
|
448. philma
|
|
quoique bon courage pour les carottes de patagnoies, c'est le seul Trondheim que je ne sois jamais parvenue à finir
Lui non plus . |
|
447. yan |
|
Sampayo travaille de façon si fusionnelle avec Muñoz que l'on peut dire qu'il dessine presque.
Moore dessinait à ses débuts. |
|
446. philma
|
|
Ce sont des dessins de jeunesse et Goscinny ce serait certainement beaucoup amélioré par la suite. Mais pourquoi s'embêter alors qu'il avait le génie d'Uderzo sous la main. Ces dessins et ces planches prouvent aussi que Goscinny avait le goût et le sens de la narration dessinée ce qui n'est pas nécessairement le cas d'écrivains de polars de série z recondertis en scénaristes de bd.
|
|
445. Bert74 |
|
J'ai un peu mieux cerné ton point de vue, mais je ne suis toujours pas d'accord.
Peut-être que je goure sur les chiffres, mais je ne vois pas en quoi, sur les données de ventes et de diffusion, Trondheim serait plus élitiste que Blacksad. Perso, je connais pas mal de mon non-férus de BD qui connaissent Lapinot, Donjon,... et pas du tout Guardino ou Loisel. Le popu, vraiment popu, c'est Hergé, Uderzo, Franquin, Van Hamme, Arleston (à la rigueur), Zep, ... Mais, amha, il n'y en a pas plus de 10. Tout le reste peut être considéré comme lu par "l'élite bédéphilique"... |
|
444. brigand
|
|
Le propre de l'art c'est quand même d'être partagé, non???
|
|
443. philma |
|
Je ne suis pas lecteur de Buck Danny mais il me semble bien en effet avoir déjà lu ça quelque part. Donc ça confirme de plus en plus les propos de Trondheim. Voilà pourquoi je ne serai jamais scénariste!
Il reste à éclaircir les cas Christin, Sampayo, Rosy, Yann(au début), Benoît Peeters, Martiny, Oesterheld, Sasturin et bien sur Moore . |
|
442. stanislas
|
|
masi on peut lui accorder qu'il est lu par un plus grand nombre de lecteurs.
Comme le dit Fred, on n'est pas à la Star Academy ici, on ne récompense pas celui qui a la plus grosse (vente d'albums). |
|
441. brigand |
|
Ouais, c'est clair qu'il faut lire quelque chose pour pouvoir l'apprécier...mais il y en a beaucoup qui ne prennent pas la peine car d'entrée de jeu ils sont rebutés par le dessin...donc finalement, ça fait une minorité qui lit ça, et je ne sais pas si c'est un scénariste somme toute élitiste qui doit décrocher le grand pris d'Angoulème.
Wolinski, je ne suis pas fan...masi on peut lui accorder qu'il est lu par un plus grand nombre de lecteurs. |
|
440. stanislas
|
|
Reconnaissons quand même ce qui est, le principal intérêt des dessins de Goscinny est qu'ils ont été réalisés par René lui-même, ce qui les rend assez touchants, mais il n'avait rien d'un génie dans ce domaine là (pas de quoi viser un grand prix).
|
|
439. omat |
|
Enfin Philma, bien sûr que Charlier dessinait ! C'est même lui qui dessinait d'une manière très appliquée les bateaux et les avions dans les premiers Buck Danny. Hubinon débutant n'était alors pas à très l'aise avec les machines.
|
|
438. Altaïr
|
|
Pour Blacksad... que dire... Guardino est un grand dessinateur, ce ne fait aucun doute. Sa maitrise des expressions de ses personnages, des perspectives compliquées réalisées avec une facilité déconcertante en sont la preuve (quoique bon c'est pas Moeb' non plus :) ). Mais il illustre plus qu'il ne raconte une BD.
Personnellement, j'ai du mal à lire Blacksad. le dessin est trop chargé, la narration correcte sans plus. Trondheim, par contre ça se dévore (quoique bon courage pour les carottes de patagnoies, c'est le seul Trondheim que je ne sois jamais parvenue à finir :) ). Son dessin est au service de son histoire, et non l'inverse. |
|
437. stanislas |
|
Il y a encore des gens (en dehors des journalistes incompétents de 20 Minutes qui viennent boucler leurs articles sur ce forum )qui arrivent à croire que Frantico est Trondheim ?
C'est fou ça ! En tous cas je tire mon chapeau à l'inventeur de cette rumeur qui a réussi à faire le tour de la presse. |
|
436. philma
|
|
Je suis très content pour Trondheim et pour la bande dessinée new generation(quoique 41 ans c'est un vieux jeune!)mais lire que Muñoz a été coiffé sur le poteau m'énerve quand même. Attendons l'année prochaine et espérons que Trondheim vote pour Muñoz avant ses potes!
En parallèle de l'interview d'actua BD je signale à Lewis Trondheim que Goscinny était lui aussi dessinateur. Un très très beau livre,aux éditions de La Martinière je crois , est sorti récemment à ce sujet. Et oui, je crois que Trondheim a raison, les bons scénaristes sont également dessinateurs. Pour le contre exemple, il reste à savoir si Charlier dessinait dans sa jeunesse. |
|
435. Coacho |
|
Suis-je plus clair a present ?
Oui, même si on n'arrive jamais à vraiment bien bien te distinguer hein ! ;o)) WAHAHAHAHAHAHAAHAHAHA ! PRESIDENT ! PRESIDENT ! PRESIDENT ! PRESIDENT ! PRESIDENT ! PRESIDENT ! (sur fonds de musique de vestiaire de foot...) ... et de Ukulélé ! ^___^ |
|
434. marcel
|
|
Je sais bien que Trondheim est inconnu pour beaucoup... comme Munoz ou Mattotti.
Je parlais juste, par "unanimite", des gens qui ont LU Trondheim (sinon, ca n'a aucun interet). L'unanimite sur la totalite du public est impossible, a part peut-etre pour Uderzo, et encore, il y a 25 ans. Autant moi qui ai lu Wolinski ou Lauzier, je dis qu'ils ne meritaient pas le grand prix, c'est credible. Je ne connais encore personne qui ait LU du Trondheim (et plus du'un album) et qui dise : c'est de la merde, ce mec-la est un naze. Suis-je plus clair a present ? |
|
433. brigand |
|
Je dis pas le contraire...j'en ai marre de me justifier...
MOI J'AIME BIEN!!! Mais on partait d'un post de Marcel qui disait qu'il ferait l'unanimité...ben, je le redis, j'ai pas mal de connaissances qui n'ont pas ouvert de Trondheim car le dessin les rebutait...moi, après avoir entendu les éloges sur ce site, j'ai fait l'effort et je ne le regrette pas...mais je peux comprendre que pour quelqu'un qui n'achète pas plus de 300 BDs pas an, ce trondheim ne soit pas en tête des priorités...même si c'est drôle, bien raconté et tout et tout...sans tomber dans la dérives Soleil, il y a pas mal de lecteurs qui se dirigerait de prime abord vers un Blacksad (pour rester dans cet exemple)plutôt que vers un lapinot...de toutes façons ce que je raconte, c'est pas un scoop, regardez les tirages.... Et qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit à savoir, que gros tirage = qualité, hein!!! |
|
432. Coacho
|
|
26. Coacho - 05/07/04 15:02 - (317620)
(…)Et si vous n’êtes pas le prochain Président d’Angoulême, c’est à n’y plus rien comprendre…(…) Ca vient un an trop tard parce que "La vie comme elle vient" était le point d'orgue attendu ! Et puis ça aurait permis à Muñoz de passer cette année ! Mais ALLELUYAH ! ALLELUYAWAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA ! C-O-N-T-E-N-T ! |
|
431. zarkham |
|
Vous avez bien lu l'article ?
Je cite un expert Trondheim : "le journaliste ne sait même pas écrire Joann Sfar correctement, donc qu’il sache le secret de Frantico serait plus un miracle qu’autre chose !!" |
|
430. larry underwood
|
|
(il faut bien, c'est son seul et unique BON film... ! quel gâchis mine de rien...)
|
|
429. rough |
|
quand on y pense, le coup le plus rusé que Frantico ait réussi a été de nous faire croire qu'il était Trondheim...
intoxiqué de Usual Singer toi :D ( et tu fais bien :) ) |
|
428. Bert74
|
|
Sérieusement, Brigand, je pense que tu rapproches un peu trop la notion de "beau dessin" de celle de "représentation figurative", alors que le propos du dessin en BD n'est vraiment pas là, mais, comme le pensent mes petits camarades (et moi), bien plus tourné vers l'aspect "lisibilité" (la perception du média en BD, se fait principalement par la "lecture" du dessin et de la planche).
Ainsi, on ne saurait taxer des gars comme Picasso ou Kandinsky de "mauvais dessinateurs" non ? A la limite, on peut se formaliser sur un beau dessin pour le choix de la couverture, la fonction de cette dernière étant, là, bien plus "illustrative". |
|
427. larry underwood |
|
enfin un prix récompensant l’auteur qui a eu la chance de vendre plein d’albums alors que sa BD est nulle recevra un « Prix Casino ».
Lewis, toujours digne. |
|
426. yan
|
|
425. brigand |
|
Prends un sac, ça éclabousse...
Pour avoir déjà lu pas mal de tes posts, je sais que t'aimes pas Blacksad...j'essaie juste de te montrer qu'il y a un gap énorme les dessins de Trondheim et d'autres...encore une fois, il a une force narrative indéniable...je me demande juste s'il était capable de dessiner autre chose que du minimaliste... |
|
424. larry underwood
|
|
quand on y pense, le coup le plus rusé que Frantico ait réussi a été de nous faire croire qu'il était Trondheim...
Mais SI C'EST BIEN LEWIS (ce que je pense de plus en plus), ça veut dire que Frantico est grand prix d'Angoulême, et ça, ça me fait bien marrer ! |
|
423. larry underwood |
|
oh-oh-oh... !
Je sens poindre un rire coachesque... |
|
422. titeuf24
|
|
"Auteur prolifique et éclectique, Lewis Trondheim, 41 ans, a signé des albums chez L'Association, Rackham ou Cornélius et des séries comme Les Formidables aventures de Lapinot ou Donjon chez Dargaud ou Delcourt. Chez Albin Michel, il a récemment publié, sous le pseudonyme de Frantico, Le Blog de Frantico."
Lu dans le monde aujourd'hui. Le journaliste repete une rumeur ou c'est devenu officiel? |
|
421. marcel |
|
Comparer Trondheim a Loisel et Blacksad (j'ai vomi)... T'es inconscient ou bien ?...
(C'est du cynisme, hein, t'inquiete...). |
|
420. brigand
|
|
Moult personneS me tomberaiENT..
|
|
419. brigand |
|
Je pensais bien que moult personne me tomberait dessus...ça donne envie de donner son avis...
Reste que, Trondheim, c'est pas Loisel!! J'aime bien (pour ceux qui n'aurait pas compris)...hein, pas taper, pas taper... Remarque, j'ai découvert y'a pas longtemps, grâce à BDparadisio d'ailleurs...mais pour moi comme pour d'autres (et qu'on ne me dise pas que ceux qui n'aime pas achètent Soleil...c'est faux...). Je sais plus le titre du dernier que j'ai lu...une histoire d'un type qui arrive en avion sur un royaume dans les nuages, il a un bandage et le roi veut toujours le tuer...bref, un bon moment. Effectivement il sait raconter les histoires et le fait que chaque ligne pouvait se lire comme un strip indépendant était intéressant...là j'ai aussi acheté Lapinot et les carottes de Patagonie, pas encore lu, mais vu la taille de ce bouquin, ça prouve bien que je n'y suis pas aalergique du tout. Reste que graphiquement, ça n'est pas Blacksad...masi là, encore, on va me critiquer pour me dire que Blacksad c'est de la M***E..alors qu'il en faut pour tous les goûts non? |
|
418. marcel
|
|
Bon, ben... deuxieme option.
|
|
417. marcel |
|
Ben, j'ai la meme hesitation que toi... ce serait bien son humour de l'avoir fait expres... mais ce serait bien son etourderie de pas l'avoiir fait expres.
|
|
416. helmut perchu
|
|
Rhaaaaaa... une honte boomerang !
|
|
415. Bert74 |
|
Helmut, je suis pas sûr que tu l'as fait exprès çui-là...
Si oui, excuse-moi, mais si non.... Whaaaf La teuhon !! |
|
414. marcel
|
|
Farpaitement ! Je suis d'accord avec machin ! C't'un grand snceratiste !
|
|
413. Bert74 |
|
Ouais, pareil qu'eux !
|
|
412. helmut perchu
|
|
Je suis d'acc' avec la mère Altaïr (et donc avec le père yan)...
... sauf que Lewis n'est pas un grand scénatiste (un grand scénraiste par contre oui !)... |
|
411. Altaïr |
|
Je suis d'acc' avec le père Yan :)
Trondheim est un grand dessinateur de BD, un grand raconteur d'histoire, un grand scénatiste... Non, franchement, j'aime des tas d'auteurs de BD mais c'était vraiment le seul choix logique (d'ailleurs il aurait dû l'avoir l'année dernière). |
|
410. yan
|
|
« Il y a une partie du lectorat pour qui les idées ne suffisent pas, mais où le dessin est important... »
Ce genre de phrase, ah le sous-entendu pas beau. Ceux qui aimeraient Lewis seraient sensibles à son humour, ses idées, sa folle imagination mais seraient des gens qui n'aiment pas le dessin? Perso le dessin est prépondérant dans mes choix de lecture en bande dessinée, important dans ma vie tout court, et Trondheim est un de mes dessinateur de bande dessinée préféré. |
|
409. marcel |
|
Tu parles des lecteurs des albums Soleil ?... Non, je parle des amateurs de BD de qualite, pour qui le "spectacle" ne prevaut pas sur le propos... Eux, ils aiment.
Trondheim fait d'ailleurs partie des tres rares auteurs que j'ai pu faire lire a des gens qui ne connaissent pas plus que ca la BD. |
|
408. Bert74
|
|
Personne ne fait jamais l'unanimité...
Goscinny ? |
|
407. brigand |
|
Personne ne fait jamais l'unanimité...
Trondheim c'est pas mal...il a son style, ses idées, et un humour décalé bien à lui...pour ça il mérite le prix...mais perso, je connais une tapée de gens qui détestent ou qui y sont hermétiques, ne serait-ce qu'à cause des dessins, que beaucoup décrivent comme simplistes. Il y a une partie du lectorat pour qui les idées ne suffisent pas, mais où le dessin est important... Bref, c'est pas parce qu'on apprécie que tout le monde l'aime également!! |
|
406. marcel
|
|
BRAVO A LEWIS !!
Voila un grand prix qui fera surement l'unanimite (ce qui n'est pas une mince affaire). Bon, en revanche, maintenant que c'est une "star", il va nous snober et plus jamais passer nous faire coucou. Bah ! Frantico passera. MOUAHAHAHAHAH |
|
405. larry underwood |
|
ah, j'suis con, je croyais que c'était pour faire comme Sfar.
|
|
404. benkun
|
|
nan, pasque ça fait plus classe : ça permet de s'affranchir de la réalité pour mieux la retranscrire de l'intérieur, comme picassault. Même si ça fait un peu mal aux yeux.
|
(http://www.BDParadisio.com) - © 1996, 2018 BdParadisio