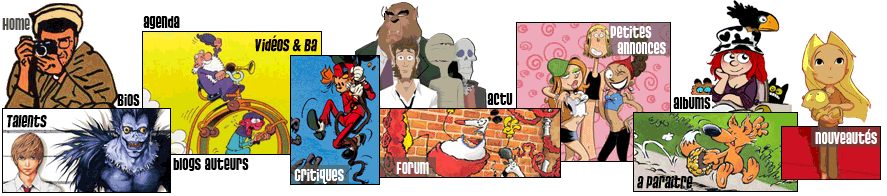Gladys (Pin-up) par Thierry Bellefroid 

« Pin-Up » N°6, par Yann et Berthet. Chez Dargaud.
Sur la couverture, un sticker annonce : « fin du deuxième round, bientôt le cycle de Las Vegas ». Pas à dire, Pin-Up, c'est avant tout une affaire qui roule. Et chez Dargaud, quand ça marche, on fait marcher tant que ça peut. Au point d'un rien effrayer le lecteur parano dans mon genre. Moi, quand on me vend l'album qui suit avant même que j'ai tourné la première page de celui que j'ai entre les mains, je trouve ça louche. Quoi, celui-ci est-il donc si mauvais que Dargaud nous rassure en nous promettant un autre cycle « bientôt » ? A moins que ce ne soit pour rassurer les naïfs qui pensaient qu'en bons pères de famille, Yann et Berthet n'allaient pas tirer sur la ficelle mais bien tirer leur révérence, en arrêtant ici leur série fétiche (-iste ?...). Enfin, quoi qu'il en soit, voici donc la fin du deuxième round, ce qui m'amène à cette première constatation : fallait-il donc trois albums pour nous le raconter ? La réponse me semble couler de source : non. Diluée, étirée, édulcorée, cette suite au cycle initial n'en est que l'ombre. Elle n'amène guère de surprises si ce n'est celle, un rien désagréable, de voir Dottie se frotter à une expérience homosexuelle qui, décidément, semble obséder tous les scénaristes en mal de chiffres de vente (Dufaux d'abord, Van Hamme plus récemment, et maintenant Yann... mais qu'est-ce qu'ils ont tous !) Heureusement, non seulement la parenthèse est vite refermée mais en plus elle est traitée avec une certaine pudeur, juste pour faire fantasmer les mecs en mal d'héroïnes bisexuelles et de caresses à la Bilitis. Yann sait ce qu'il fait. Berthet aussi, d'ailleurs. Pin-Up se vend sous toutes les formes : habillée en album, moins habillée en sérigraphie, glamour en figurines de plomb, rétro en affiches ou sur les bouteilles d'armagnac, j'en passe et des moins belles. Les produits dérivés deviennent plus importants que le personnage et cela se ressent sur l'esprit de la série, calqué à 100% sur l'attente d'un public qui en redemande. Pourtant, étant l'heureux possesseur d'un tirage de tête de deux des albums de cette série (non, vous n'aurez pas mon adresse. D'ailleurs, je n'ai que ceux-là, je ne suis pas collectionneur !), je ne cesse pas de m'émerveiller du talent de Berthet. Ses crayonnés sont souvent plus beaux que le résultat publié, même s'il faut lui reconnaître un encrage intelligent et une coloriste tout à fait « dans le ton ». Alors quoi ? On attendrait peut-être un brin de sincérité, quelque chose de plus désintéressé. Mais si ça se trouve, le public ne serait pas d'accord. Car malgré tous les reproches qu'on peut faire aux auteurs, c'est avant tout ceux qui les lisent qui ont fait de Pin-Up ce qu'elle est aujourd'hui : un produit de grande consommation.
PS. Vous aviez des doutes sur l'indépendance d'esprit du chroniqueur de bdparadisio ? Cette chronique devrait les dissiper. Le fait que ce site organise un concours Pin-Up avec albums à la clé ne m'empêche nullement de dire ce que je pense...