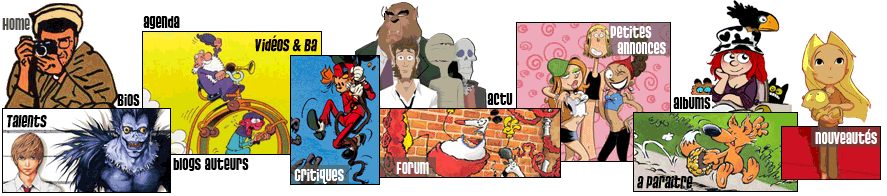Le canard de l'angoisse par Thierry Bellefroid 

« Le canard de l'angoisse », album collectif. Aux éditions Fluide Glacial.
Comme le raconte très bien Gotlib dans l'avant-propos, il s'agit d'une variation sur le thème du cadavre exquis cher aux surréalistes. Variation car ici, chacun ne travaille pas dans l'ignorance de ce qu'ont fait les autres. Au contraire. Chaque nouveau dessinateur s'appuie sur ce qu'ont fait ses prédécesseurs et invente une suite de deux pages au récit qu'il reçoit. L'exercice -auquel tout le monde s'est livré au moins une fois, ne fût-ce qu'oralement- est évidemment hautement risqué. Et le résultat, comme prévu, n'a ni queue ni tête. Ce qui n'empêche pas quelques jolies trouvailles. A la lecture de l'album, on distingue d'ailleurs plusieurs styles d'auteurs. Il y a ceux qui continuent l'histoire -et tentent parfois de lui redonner un peu de sens, fût-ce dans l'absurde. Il y a ceux qui préfèrent inventer quelque chose : nouveau héros (ou nouvelle héroïne, comme c'est le cas de la Nadège inventée par Blutch et qui devient un personnage récurrent) ou nouvelle situation. Et il y a ceux dont le seul but est de foutre un peu le bordel. Ceux-là jubilent en réalisant une dernière case qui va mettre les autres dans l'embarras. A côté de ses défauts (l'absence totale de scénario est la principale) « Le canard de l'angoisse » recèle des qualités propres à ce genre d'albums et la moindre d'entre elles n'est pas de nous proposer un panorama complet des auteurs maison. Parmi eux se trouvent quand même quelques sacrées pointures. Les pages dessinées par Blutch, Goossens, Tha/Tharrats, Larcenet ou Gaudelette mettent en avant la double qualité des grands auteurs de Fluide Glacial : talent et personnalité. De la personnalité, le dessin des autres est loin d'en manquer. Qu'on prenne Maester, Solé, l'inimitable Binet, Moerell, Coyote, Tronchet, Ferri, Foerster, Carlos Gimenez, Lelong, Raynal... chacun a son style et pourtant, ensemble, ils forment une sorte d'école « Fluide ». Si cette fable délirante sur le bug de l'an 2001 a un intérêt, c'est bien celui de mettre en avant des signatures qui, ensemble, constituent une véritable écurie, une « marque de fabrique », celle que le magazine parvient à cultiver depuis 25 ans.